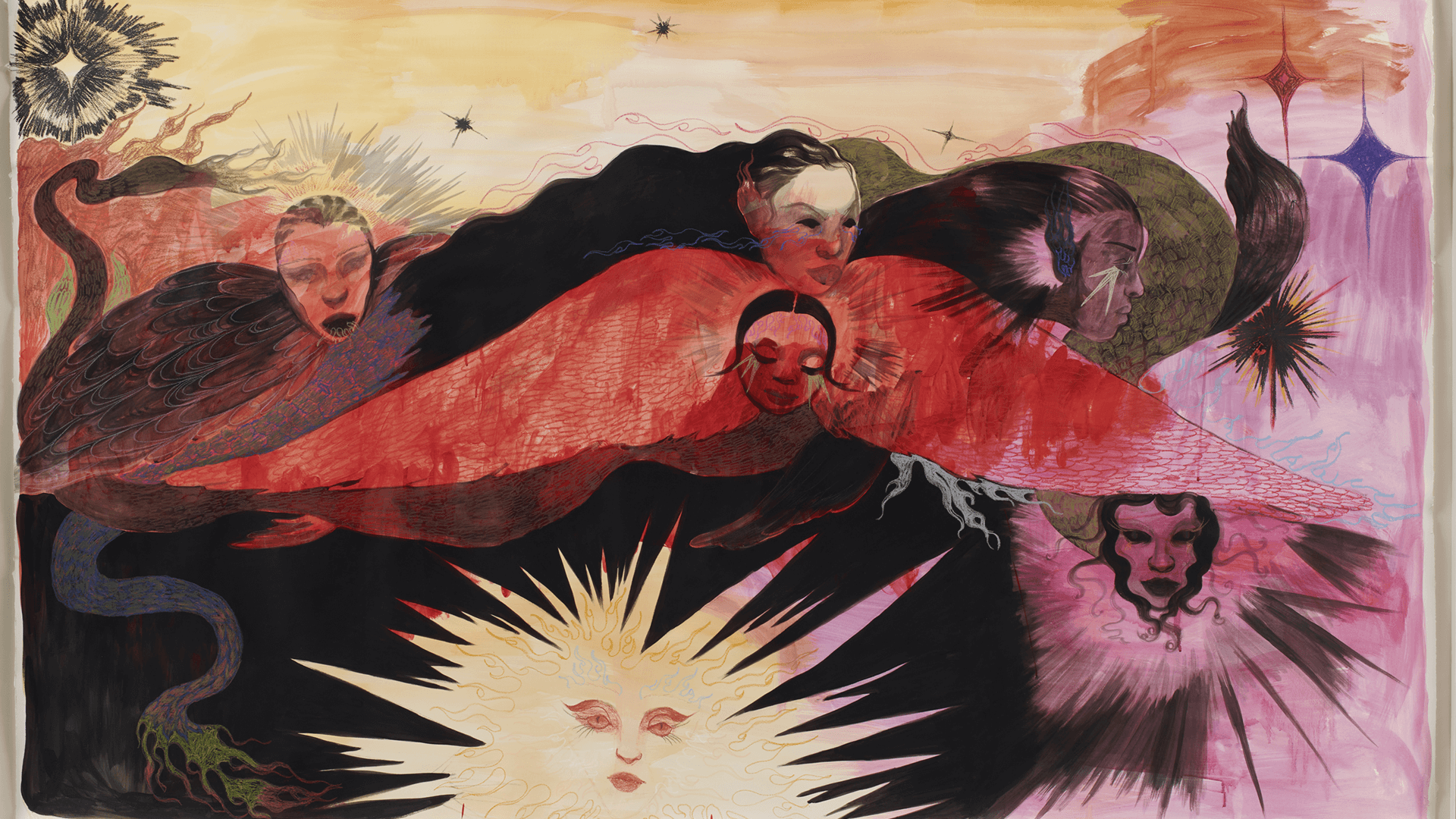RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien avec Dorothee Munyaneza par Amandine Nana
Tu as conçu ta pièce « Toi, moi, Tituba… » en dialogue avec un texte d’Elsa Dorlin, rendant hommage au roman « Moi, Tituba sorcière… » de Maryse Condé ainsi qu’aux voix et corps effacés, tus, meurtris. L’oeuvre et la présence de Maryse Condé dans nos pratiques respectives nous réunissent aujourd’hui, et ce n’est pas anodin.
Dorothée Munyaneza : En 2016, j’ai été invitée à performer dans la pièce Hunted, conçue par Okwui Okpokwasili et Maud Le Pladec. Hunted tourne autour de la figure de la sorcière comme symbole de la résistance aux systèmes de pouvoir, notamment au capitalisme. J’ai commencé à lire différentes choses par curiosité. Je suis tombée sur Moi, Tituba sorcière…*, mais je n’ai pas terminé le livre. Sept ans plus tard, on me propose de faire partie de L’ADN Dance Living Lab à Chaillot – Théâtre national de la danse, un projet invitant des artistes du spectacle vivant à travailler en binôme avec des chercheur·ses en sciences humaines. Pour moi c’était évident de travailler avec Elsa Dorlin, que j’avais rencontrée l’année précédente, parce qu’elle est une des plus grandes philosophes de notre temps ! Elle m’a alors proposé son texte Me, You, Us : I, Tituba and the Ontology of the Trace [ Moi, toi, nous… : Tituba ou l’ontologie de la trace] qu’elle venait d’écrire. J’ai retrouvé Tituba et Maryse Condé à travers ce texte et repris la lecture de son roman. Et j’ai plongé d’une traite ; j’ai été complètement éprise par cette écriture. Tituba m’a habitée depuis ce moment, jusqu’à la création, et elle est encore là. Elle ne me quittera plus, je pense.

Ton oeuvre est le passage d’un texte à la danse, où le corps est investi comme une archive. Comment traduis-tu cela en un vocabulaire de mouvements pour ta pièce ?
DM : Que ce soit le texte d’Elsa Dorlin ou celui de Maryse Condé, j’ai réellement pris le temps, notamment avec le compositeur et musicien Khyam Allami, de les utiliser également comme des indicateurs de chorégraphie. Par exemple, il y a un passage très clair dans le roman quand Tituba entre dans une pièce, elle va d’un côté à un autre, elle brûle l’eucalyptus, tel un rituel chorégraphique que Maryse Condé s’est employé à créer pour elle. Elsa Dorlin dit : « Devenir Tituba, c’est suivre le roman de Condé comme une méthode […], pour saisir et ranimer ce qui subsiste à l’état de trace fantomale dans le monde silencieux des archives coloniales. » Dans ma performance, j’emporte Tituba avec moi, je chemine avec elle. Je deviens aussi cet endroit d’archives. Ce sont justement ces questions qui m’ont inspirée : qui est dans les archives, qui est archivé·e, qui archive, qui a droit aux archives, qui peut y avoir accès, qui en est complètement effacé·e, éradiqué·e, silencié·e ? Le travail que je mène en tant que chorégraphe est une façon de réactiver une certaine archive, et d’en créer d’autres. Mon corps et celui de celles et ceux avec lesquel·les je collabore font partie de cette création ou deviennent des archives vivantes. Il y a des empreintes que nous avons en nous, sur nous. Ce que l’on porte, qui est visible ou invisible, et ces liens avec les aïeux, les aïeules, les terres plus ou moins lointaines, d’où l’on vient, auxquelles on est lié·es ou auxquelles on appartient aujourd’hui, font partie de ces archives.
De quelques lignes tirées des minutes d’un procès pour sorcellerie au 17e siècle, Maryse Condé a créé toute une oeuvre monumentale autour du nom de Tituba. C’est cette histoire-là qui a marqué tant de vies dans la diaspora, dans tellement de pays, sur tellement de terres, au fil du temps, jusqu’à aujourd’hui, et je suis certaine que, dans des siècles encore, on reviendra sur ce livre.

Lorsqu’on regarde entre l’Afrique, les États-Unis ou les Caraïbes, les similitudes qu’il y a dans les danses africaines et afrodiasporiques à travers le temps, on en revient encore à cette idée que le corps est, comme tu le dis, une archive de mouvements qui ont été transmis.
DM : Je pense qu’il est aussi question du mouvement des corps, du déplacement, notamment de ce corps diasporique. C’est pareil en musique. Et dans le marronnage, la transmission qui résidait au coeur de la résistance a fait que certains peuples ont pu faire passer une connaissance tellement ancienne, qui a traversé les océans, aux générations d’après. Pour moi, la danse, c’est ce langage : il y a comme une résistance à l’anéantissement et à l’oubli qui passe par la chorégraphie. Le geste porte une mémoire. Comment est-ce qu’on continue de rendre hommage à celles et ceux qui ont traversé autant de violence ou de vécu ? Parce que toutes les traversées ne sont pas liées qu’à la violence ; il y a aussi beaucoup de joie dans ce que nous vivons, dans ce que nous transportons, ce qui nous habite, nous anime, dans tout ce qui nous meut. Tout cela fait partie de l’amplitude de l’archive. Et elle est là, encore une fois, elle est vivante.
L’exposition est également une forme éphémère. Une question que je me pose en tant que curatrice et historienne de l’art est : quelles sont les archives qui en restent et qui font que demain quelqu’un va pouvoir se tourner vers elles ?
DM : Créer ce lien dans les archives, c’est continuer à exister, et créer presque quelque chose qui nous survivra et qui inspirera ou portera la prochaine génération, les autres générations. Dans Toi, moi, Tituba…, j’ai vraiment travaillé la chorégraphie, la musique et le son comme une archive présente, avec laquelle toi ou d’autres avez pu être en lien direct, mais aussi comme une future archive.
Dans le roman de Maryse Condé, Tituba est une guérisseuse. Elle dit elle-même que si c’est ça qui lui vaut d’être taxée de sorcellerie, elle accepte d’être une sorcière. Comment envisages-tu la dimension rituelle et somatique de la guérison dans ta pièce ?
DM : Je pense toujours l’espace de la performance comme un lieu de cérémonie, depuis une conversation que j’avais eue avec mon amie et artiste Hlengiwe Lushaba Madlala qui, un jour, m’a dit : « Ma soeur, ce que nous faisons, ce n’est pas simplement une performance, c’est une cérémonie. » Donc la chorégraphie fait partie de cette réflexion sur la cérémonie, dans laquelle il y a l’acte de tisser, de « raccommoder ce qui a été rompu », comme le dit si bien Hlengiwe Lushaba Madlala. Peut-être qu’au final c’est nous-mêmes que nous sommes en train de réparer, ou alors c’est le récit.
Et dans le récit, il y a celles et ceux qui ont été affecté·es, qui peut-être seront réparé·es par ce geste artistique. Le fait de guérir par l’acte créatif est un langage d’engagement : avec le vivant, avec ce qu’il est possible de préserver, de sauver, de soigner. Je reviens au texte d’Elsa Dorlin : « Devenir Tituba, s’en aller prendre soin des vies qui gisent dans les archives. »
L’ exposition rappelle que dans nos quotidiens et nos espaces domestiques, on a tous·tes des rituels, des formes de cérémonies et de protections spirituelles. Ce terme est aussi présent dans le texte « Dub : Finding Ceremony » d’Alexis Pauline Gumbs où elle nous invite à nous questionner sur notre manière de respirer. Peux-tu m’en dire un peu plus sur ton expérience de la respiration dans ces moments de cérémonie que tu crées ?
DM : C’est une pièce qui demande une respiration très profonde. Je suis obligée d’être en maîtrise de mon souffle et de savoir où je pose mes mots. Et surtout, j’avais envie de ne pas être épuisée à la fin : je souhaitais que cette pièce me revigore dans le sens spirituel. J’avais envie de me sentir puissante à la fin de la représentation. Et la musique y est pour beaucoup. Le système avec lequel Khyam Allami crée la musique propose à chaque fois de nouveaux éléments qui viennent me redonner plusieurs souffles. Et il y a des moments où je deviens un autre type de vivant. Tituba ou toutes les autres que j’emmène avec moi dans cette pièce ne sont pas que humaines ; elles relèvent de ce qui respire, ce qu’on inspire, ce qui nous inspire, ce qu’on expire. C’est donc ce souffle de la vie qui donne l’impression que je deviens animale, parce que j’inspire d’autres vies, d’autres souffles, et j’utilise mon corps comme espace de résonance et d’amplification. La respiration est aussi une manière pour moi de réguler celles et ceux qui sont avec moi à ce moment-là. Vous qui regardez, je tisse avec vous. Donc la respiration, je l’emploie pour être en lien, en lien avec vous. C’est une manière de réguler nos échanges et de réguler ce langage d’inspiration et d’expiration.

Devenir Tituba, c’est ne jamais être seule, puisqu’elle est toujours entourée de ses invisibles. Pourtant, elle me touche dans son isolement. Ta pièce est d’ailleurs présentée comme un « solo collectif ». Tituba est nos grands-maternités personnelles, qu’Elsa Dorlin développe dans son essai. Tituba est toutes les entités et personnes qui sont avec nous dans la cérémonie.
DM : Oui, c’est une figure ramifiée, maillée. Tituba est cette force qui, depuis son isolement, nous entraîne justement vers cell·eux qui continuent de nous accompagner dans le monde visible et invisible. Là, Tituba est le lien entre toi et moi. Elle est le lien entre Elsa Dorlin et Maryse Condé. Elle continue à créer des racines, des connexions. Quelque chose continue de se déployer, notamment dans les offrandes que nous faisons à travers les cérémonies, les expositions, les performances, les écrits, les romans, les réflexions philosophiques. Tituba, c’est comme si elle venait redonner du souffle à ce mouvement qui est ce lien dans cette diaspora au-delà des mers, au-delà des terres. Comment reste-t-on connecté·es ? Quels sont ces liens et comment en prend-on soin aujourd’hui ?
Dans le roman de Maryse Condé, on suit le personnage dans son après-vie, qui devient cet esprit de résistance, avec le principe d’un « devenir ancêtre ». Est-ce que ce « devenir ancêtre », même de notre vivant, est quelque chose qui résonne avec toi ?
DM : Dans mon travail, je traverse plusieurs états, je suis en train de vivre presque plusieurs vies, plusieurs êtres, donc dans ce moment précis du geste et du chant, je suis devenue ancêtre. Pour moi, les ancêtres sont là pour nous apporter conseil, nous apporter clarté, apaisement, douceur, amour. Tout n’est pas toujours très gai chez les ancêtres, ils viennent aussi nous remuer, créer de l’inconfort à un endroit. Donc, ce geste qui est le nôtre, qui est celui d’autres collaborateur·ices qui sont mu·es et ému·es par l’ancestralité, ou qui y réfléchissent en tout cas, c’est encore une fois cet amour. Ce geste est ancré dans l’amour de la transmission. On est en train de « nous » léguer en créant. C’est dans la question de transmission que je me sens, d’une certaine manière, devenir ancêtre. Alors qu’on commémore actuellement le génocide des Tutsi au Rwanda [en 1994], j’ai montré à mes enfants une captation de ma première pièce Samedi détente (2014) en disant : voilà ce que j’ai vécu il y a trente ans, et aujourd’hui je suis encore à vos côtés et je serai un jour non plus visible, mais je serai là d’une autre manière. Donc oui, devenir ancêtre, c’est croire aux traces, c’est croire à ce qu’on laisse, ce qu’on donne, ce qu’on a reçu aussi et qu’on transmet. On n’est que dans la transmission.